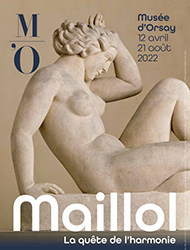Chef-d’œuvre de Jean Nocret (1615-1672) s’étalant sur près de 12 m2, la spectaculaire Famille royale dans l’Olympe est vraisemblablement le plus grand portrait du XVIIe siècle français parvenu jusqu’à nous. Cette toile insigne, bien connue des visiteurs de Versailles, a quitté depuis septembre les boiseries du salon de l’Œil-de-Bœuf jouxtant la chambre du Roi afin de bénéficier de 14 mois de restauration.
Il trône en Apollon au cœur de la composition. Coiffé d’une couronne de lauriers, le Roi-Soleil règne sans partage sur l’Olympe au milieu de sa famille : la reine Marie-Thérèse est représentée en Junon, son fils, le Grand Dauphin, est l’Amour, sa cousine, la Grande Mademoiselle, jadis frondeuse, est Diane, tandis que sa mère, Anne d’Autriche, est dépeinte en Cybèle. Véritable apothéose du mythe apollinien, cette toile immense est pour le visiteur d’aujourd’hui indissociable de l’esthétique versaillaise. C’est pourtant pour le château de Saint-Cloud, propriété de Monsieur, frère du roi, que fut livré par Jean Nocret, vers 1670, au soir de sa carrière, ce portrait de famille historié. Le prince s’y fait d’ailleurs représenter à gauche de la composition en Étoile du Point du Jour, annonciatrice du lever du Soleil.
Jean Nocret : au service de Monsieur
Peintre attitré du fantasque Philippe d’Orléans depuis le début des années 1650, le Lorrain Jean Nocret livrera durant sa carrière de multiples effigies des membres de la famille royale, tout en contribuant aux décors de plusieurs grandes demeures, ornant notamment les appartements de la reine Marie-Thérèse au palais des Tuileries. C’est cependant au château de Saint-Cloud, propriété de Monsieur depuis 1658, que son talent sera tout particulièrement mis à contribution. Il interviendra ainsi largement dans le gracieux décor des cinq pièces composant les appartements d’Henriette d’Angleterre, première épouse de Philippe d’Orléans. C’est pour le décor de l’antichambre du prince, pièce dans laquelle il se plaisait à prendre ses repas, que Nocret exécutera le grand portrait de la famille royale trônant sur l’Olympe : cette composition magistrale, dont la délicatesse seyait à merveille à l’atmosphère de ce château dédié aux plaisirs, sera considérée, dès sa disparition en 1672, comme son chef-d’œuvre.
De Saint-Cloud à Versailles
Elle échappera fort heureusement à l’incendie qui en 1870 ravagea Saint-Cloud et eut raison des autres décors de l’artiste. La toile avait en effet à cette date quitté depuis plusieurs décennies les cimaises du château pour gagner, à la demande de Louis XVIII qui envisagea en 1814 de se réinstaller à Versailles, les boiseries du salon de l’Œil-de-Bœuf. Ce dernier accueillait jusqu’à la Révolution une grande toile de Véronèse, Esther et Assuérus (aujourd’hui au Louvre), dont le sujet, plus austère, correspondait au goût de Louis XIV pour la grande peinture française et italienne. Le projet de restauration du statut de résidence royale de Versailles fera long feu, mais l’œuvre restera en place, maintenue par les dirigeants successifs.

Une restauration fondamentale
Déposée pour la dernière fois entre 1984 et 1986, la toile nécessite aujourd’hui une restauration fondamentale. Les premières images scientifiques livrées par le C2RMF ont déjà dévoilé l’existence de plusieurs repentirs ainsi que l’usage du précieux lapis-lazuli pour le ciel et certains costumes. Première étape du processus de restauration, la dissolution des anciens vernis, désormais jaunis, et le retrait des repeints, a commencé. Un deuxième temps permettra de traiter la toile et le châssis avant la réintégration des lacunes et des usures. Cette restauration s’inscrit dans le cadre du chantier du salon de l’Œil-de-Bœuf qui devrait s’achever en avril 2024.

Olivier Paze-Mazzi