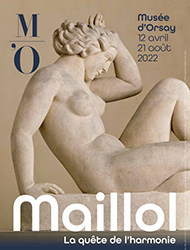Sculptrice majeure du XXe siècle, Germaine Richier (1902-1959) déchire la matière, triture et malmène les corps, traque inlassablement le mouvement, hybride les êtres… Ses œuvres puissantes ont rencontré une fulgurante notoriété de son vivant, avant de sombrer dans un relatif oubli. La magistrale rétrospective que lui consacre le Centre Pompidou est donc un événement attendu ! En partenariat avec le musée Fabre de Montpellier, qui déploiera à son tour l’exposition cet été, le parcours replace l’artiste sur le devant de la scène au fil de 250 sculptures, dessins, gravures et photographies couvrant l’ensemble de sa carrière. Mentionnons parmi les nombreux chefs-d’œuvre réunis pour l’occasion L’Araignée, L’Orage et L’Ouragane, Le Christ d’Assy, La Montagne, Échiquier grand… Nous vous proposons de revenir sur les origines de cette exposition essentielle avec sa commissaire Ariane Coulondre, conservatrice en chef des collections modernes au musée national d’Art moderne.
Propos recueillis par Myriam Escard-Bugat.
Pouvez-vous revenir sur la genèse de ce projet ?
En 1956, Germaine Richier est la première artiste femme à faire l’objet d’une exposition de son vivant au musée national d’Art moderne. C’est pour elle une consécration qui témoigne de la place majeure qu’elle occupe dans la création contemporaine. Cette trajectoire est cependant vite interrompue par sa disparition précoce en 1959. Depuis lors, ses sculptures n’ont cessé d’habiter les salles du musée, au Palais de Tokyo puis au Centre Pompidou. Nous souhaitions toutefois depuis longtemps lui consacrer une rétrospective complète pour affirmer la singularité de son parcours et de sa création, en particulier en la sortant de l’ombre d’Alberto Giacometti auquel elle est souvent comparée.

Avez-vous découvert des œuvres et des documents inédits ?
L’exposition réunit beaucoup de pièces uniques et peu connues, comme les œuvres en plomb de la fin de sa carrière, qui permettent au public de découvrir toute la diversité de sa création. Concernant les fonds d’archives, pour beaucoup encore en mains privées, nous avons mené une véritable enquête depuis trois ans en France, en Suisse, en Belgique, à Londres et aux États-Unis, où elle a plusieurs fois exposé. Ces fonds, en particulier les correspondances entre Richier et ses proches, constituent une mine d’informations qui reste encore à exploiter pleinement. Les lettres permettent de savoir ce qu’elle fait et pense presque au jour le jour ! On y mesure sa place centrale au sein des cercles artistiques et littéraires de l’époque. On apprend qu’elle a aussi été beaucoup photographiée : par Brassaï bien sûr, mais aussi par Irving Penn ou encore Agnès Varda, qui fait des photographies en couleur de son atelier.

Pourquoi qualifiez-vous Richier de maillon entre Rodin et César ?
Comme son travail est figuratif et à première vue « classique » dans sa mise en œuvre (modelage de la terre, modèle vivant, tirage en bronze), Richier a parfois été perçue comme une digne héritière de Rodin et de Bourdelle, dont l’œuvre viendrait clore une histoire de la statuaire française. Il faut pourtant souligner son rôle-clef dans l’art moderne. Sa postérité est considérable après-guerre, en France comme à l’étranger : elle inspire aussi bien le jeune César que toute une génération de sculpteurs britanniques dans les années 1950. En France, où il existe d’un côté des musées du XIXe siècle et de l’autre des musées d’art moderne, ces deux moments de la sculpture peuvent parfois sembler disjoints. Or, le parcours de Richier montre bien que c’est une histoire continue, avec moins de ruptures que de tournants, comme l’essor de la pratique de l’assemblage…
Sa capacité à transcender le réel la rapproche-t-elle du surréalisme ?
L’exposition part du rapport fondamental de Richier à l’humain. L’artiste s’appuie toujours sur le modèle vivant mais dit vouloir « faire mentir le compas » pour faire évoluer à sa guise la structure géométrique dans laquelle est enserrée la forme. L’hybridation, qui prend une importance grandissante après-guerre, lui permet de régénérer la représentation de l’humain, de le doter de pouvoirs tels que l’envol, le saut. Richier a souvent été associée au surréalisme mais elle s’est très peu exprimée à ce sujet. Quand elle parle de ses sculptures d’insectes, par exemple, elle évoque son enfance dans la garrigue et les colonies de fourmis, mantes et sauterelles avec lesquelles elle jouait. Certes, elle se lie à des écrivains proches du surréalisme qui vont beaucoup orienter le regard porté sur son œuvre, mais contrairement à Giacometti, elle n’a jamais appartenu au surréalisme historique d’André Breton. René de Solier la rapproche, quant à lui, de l’art fantastique, un terme assez ouvert. Il ne faudrait pas se cantonner à cette lecture littéraire de son art : il est surtout essentiel aujourd’hui de donner à voir ses œuvres et de souligner sa formidable inventivité plastique.
Vous exposez de nombreuses œuvres de premier plan, comme L’Échiquier, grand. Que nous dit cette pièce majeure, réalisée peu avant sa disparition ?
Gravement atteinte d’un cancer, l’artiste fait faire des tirages en plâtre de son Échiquier, grand qui représente à échelle humaine les cinq principales pièces du jeu d’échecs ; elle va ensuite les peindre. La couleur apparaît dans son œuvre dès 1952 et c’est pour elle une manière d’apporter de la joie, de la vitalité. On peut imaginer qu’elle aurait continué à développer ce travail tout à fait fascinant, qui montre son lien avec l’abstraction lyrique de l’époque. Car, bien qu’elle ne soit pas une artiste abstraite, la sculptrice a plusieurs fois collaboré avec des amis peintres appartenant à ce courant, comme Maria Helena Vieira da Silva, Zao Wou-Ki et Hans Hartung. Selon un commentateur de l’époque, Richier est la seule à pouvoir faire le lien entre les grands artistes figuratifs, plutôt placés du côté de la tradition, et les avant-gardes les plus radicales à l’époque, qui défendent l’abstraction. Elle dépasse cette opposition.


Pour aller plus loin :
L‘Objet d’Art hors-série n° 165
Germaine Richier
64 p., 11 €.
À commander sur : www.lobjet-dart-hors-serie.com
« Germaine Richier »
Jusqu’au 12 juin 2023 au musée national d’Art moderne – Centre Pompidou
Place Georges Pompidou, 75004 Paris
Tél. 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr