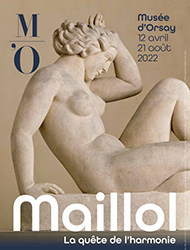Après avoir sorti de l’ombre en 2020 le peintre Jean-Marie Delaperche (1771-1843), le musée des Beaux-Arts d’Orléans poursuit sa vertueuse entreprise de remise en lumière d’artistes ayant contribué au dynamisme artistique de la ville. C’est désormais au tour de Jean Bardin (1732-1809) de gagner le devant de la scène. Remarquable peintre d’histoire et dessinateur hors-pair, il n’avait jusqu’à présent jamais bénéficié d’une rétrospective, malgré son prix de Rome et sa position de membre agréé de l’Académie royale. Déployée dans un écrin signé Nathalie Crinière, cette toute première réunion de son corpus dévoile au public plus d’une centaine d’œuvres largement inédites.
Avant de gagner Orléans à l’âge de 53 ans dans le courant des années 1780, Jean Bardin connaît une première vie dans la capitale. Issu d’une famille d’agriculteurs, ce Bourguignon monté à Paris à l’âge de seize ans s’imagine d’abord vouer sa vie au commerce. On n’échappe cependant pas à sa vocation : huit ans plus tard, il embrasse la carrière de peintre d’histoire en faisant ses premières armes dans l’atelier de Lagrenée l’Aîné (1725-1805), puis dans celui de Jean-Baptiste Marie Pierre (1714-1789). Lauréat du deuxième grand prix de Rome en 1764, il tente à nouveau sa chance dès l’année suivante.

Une scène d’horreur
1765. Puisant son origine dans l’histoire romaine, le sujet fixé cette année par l’Académie est particulièrement terrible : il met en scène le parricide commis par Tullie la Jeune qui ordonne de faire rouler son char sur le cadavre de son père Servius Tullius afin d’offrir le trône à son époux Tarquin le Superbe. L’exposition réunit les toiles de trois des peintres en lice cette année-là : François-Guillaume Ménageot (1744-1816), Jean Siméon Berthélemy (1743-1811) et Bardin. Alors que ses concurrents optent pour des compositions excessivement denses, ce dernier s’en distingue en livrant une vision simple et lisible de l’épisode. Cette sobriété nouvelle de la peinture d’histoire, plus proche de l’antique, séduit le jury : Bardin remporte le premier prix de peinture.

Espoir de la peinture d’histoire
Alors que Bardin gagne ses premiers lauriers, la peinture d’histoire traverse une période trouble, marquée par l’éloignement de Fragonard, la fin de carrière de François Boucher, ainsi que la disparition en 1765 de Carle van Loo et du jeune Deshays, l’une de ses étoiles montantes. Durant sa formation de trois ans à l’École royale des élèves protégés, le peintre s’attire rapidement ses premières commandes, à l’image d’un important Martyre de saint Barthélemy, restauré après sa redécouverte récente dans l’église de Mesnil-le-Roi à la faveur de l’installation d’un orgue. L’artiste s’inspire ici assez ouvertement du Martyre de saint Érasme de Nicolas Poussin, citant presque littéralement la figure du prêtre désignant de sa main le dieu antique. Il contribue également quelques années plus tard par une Éducation de la Vierge à l’embellissement de la cathédrale de Bayonne, avant de prendre la route de l’Italie accompagné du jeune Jean-Baptiste Regnault et du sculpteur Pierre Julien. Durant les quatre années passées dans la Ville éternelle, Bardin s’ouvre au paysage, mais aussi à l’architecture, comme en témoignent dans l’exposition deux études de fronton qui firent partie de la collection de l’architecte Pierre-Adrien Pâris.

Le triomphe du Colisée
De retour en France en 1772, Jean Bardin approfondit son exploration de ses sujets favoris, déployant vestales, vases et sacrifices antiques sur de grands dessins autonomes, medium hautement prisé des amateurs à l’orée de cette nouvelle décennie. La première exposition publique de ses œuvres au sein du salon des Grâces aménagé à Paris dans l’éphémère Colisée suscite l’enthousiasme des critiques qui louent tout particulièrement ses talents de dessinateur ; on souligne notamment les grandes qualités de deux importantes feuilles aux crayons noir et blanc de plus d’un mètre de large chacune figurant L’Enlèvement des Sabines et Le Massacre des Innocents. Acclamé par la critique, Bardin suscite l’intérêt de grands amateurs, à l’image du prince de Saxe-Teschen ; l’Albertina de Vienne conserve aujourd’hui six dessins de l’artiste issus de cette prestigieuse collection, dont une grande feuille, exposée ici pour la première fois, mettant en scène des Bacchantes décorant la statue du dieu Pan. Elle est caractéristique de l’art de Bardin de gouacher le dessin de manière très picturale.

Quo non ascendet ?
Le triomphe du Colisée facilite grandement l’entrée de Bardin à l’Académie qui l’agrée le 27 mars 1779 et lui ouvre les portes du Salon et des commandes officielles. La direction des Bâtiments du roi le sollicite vite pour l’exécution d’une Adoration des Mages destinée à la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau, tandis que Madame Louise, tante de Louis XVI, lui propose de réaliser une Immaculée Conception pour la chapelle du Carmel de Saint-Denis où elle s’était retirée en 1770. En marge de cet afflux de commandes, Bardin travaille à son morceau de réception ; l’esquisse de son Mars sortant des bras de Vénus pour aller à Troie est validée par l’Académie en 1782. Pourtant, le tableau final ne sera jamais soumis à l’approbation de l’institution…
L’œuvre d’une vie : Les sept Sacrements de la chartreuse de Valbonne
Comment expliquer cette procédure inachevée qui prive le peintre de l’enviable statut d’académicien ? Deux éléments de réponse peuvent être proposés. En 1780, l’artiste reçoit la commande la plus importante de sa carrière : un grand cycle consacré au sept Sacrements pour la chartreuse de Valbonne (Gard). Monumentales, les toiles occuperont largement l’artiste durant cette décennie : six seront livrées entre 1782 et 1790, tandis que la septième sera terminée en 1791. Le cycle est exceptionnellement accueilli complet à Orléans : la loi de 1901 qui impose aux congrégations de solliciter une autorisation législative ayant poussé les moines à quitter la France, les toiles sont en effet depuis lors conservées de l’autre côté des Pyrénées à Saragosse, ornant le gigantesque réfectoire de la chartreuse d’Aula Dei. La réalisation de ce grand œuvre a assurément retardé l’achèvement du morceau de réception de l’artiste. Une deuxième explication permet de tisser le lien avec Orléans : en 1786, Bardin est choisi par l’Académie royale pour prendre la direction de la nouvelle École gratuite de dessin d’Orléans voulue par le collectionneur et mécène Aignan Thomas Desfriches. Cette séduisante opportunité, synonyme pour l’artiste père de famille de salaire régulier, relégua donc vraisemblablement au second plan ses ambitions institutionnelles.

Un pédagogue à Orléans
Sous l’impulsion de Desfriches, la cité johannique connaît au crépuscule du siècle des Lumières un remarquable dynamisme artistique que symbolise l’arrivée de Bardin. À la fois directeur et professeur, il partage désormais son temps entre l’instruction des esprits, la poursuite de ses Sept Sacrements, et l’envoi à Paris d’une production destinée au Salon. Il traversera la période révolutionnaire sans jamais cesser d’enseigner et sera à l’origine en 1799 de la création du premier Muséum dédié à la peinture ancienne, ancêtre de l’actuel musée. Père de deux enfants, ce grand pédagogue saura transmettre le goût des arts à sa fille Ambroise Marguerite, qui se fera connaître par la pratique de la gravure, du pastel et de la peinture sur porcelaine.

Olivier Paze-Mazzi
« Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré »
Jusqu’au 14 mai 2023 au musée des Beaux-Arts d’Orléans
Place Sainte-Croix, 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 86
www.orleans-metropole.fr
Catalogue, coédition musée des Beaux-Arts d’Orléans / Le Passage, 304 p., 38 €.