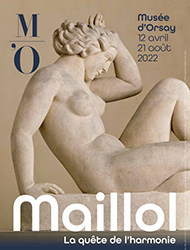Le projet architectural qui transformera à l’horizon 2026 la caserne Sully en musée du Grand Siècle a été dévoilé hier par Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine : il s’agit de celui de Rudy Ricciotti, Grand Prix national d’architecture en 2006 et médaille d’or de l’Académie d’architecture, qui en 2012 avait offert au département des Arts de l’Islam du Louvre son écrin avant d’inaugurer un an plus tard le Mucem de Marseille. Directeur de la mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, Alexandre Gady revient à cette occasion pour L’Objet d’Art sur l’avancement du chantier.
Propos recueillis par la rédaction.
Le projet du musée du Grand Siècle a été lancé il y a trois ans : où en êtes-vous ?
Une formidable énergie positive nous porte et nous franchissons les étapes les unes après les autres, avec la claire conscience de la chance que nous avons de pouvoir créer un nouveau musée, au service d’un territoire et du public. Le succès d’une telle entreprise repose sur une volonté politique forte, que porte le Président du département des Hauts-de-Seine Georges Siffredi, soutenue par des moyens humains et financiers et l’expertise de l’administration du Département. Ces conditions étant parfaitement réunies, nous sommes en mesure de faire advenir un grand musée dans quatre ans, au sein de la « vallée de la Culture » : si cela paraît loin, je vous assure que notre emploi du temps est bien rempli jusqu’à l’ouverture. Par ailleurs, la Mission de préfiguration s’est renforcée et compte désormais douze personnes, dont trois conservateurs. Enfin, une Société des amis du musée, que préside Clémentine Gustin-Gomez, a été créée : elle nous a offert un premier tableau en juin, une belle nature morte de Reynaud Levieux.
Comment transforme-t-on une ancienne caserne en un musée ? À quelles difficultés étiez-vous confronté et comment avez-vous conçu le programme architectural ?
Un musée est à la fois une collection et un propos scientifique, c’est également un bâtiment. Ici, comme souvent, le pari était de transformer l’existant, en mettant ses qualités au service du projet, avec un infini respect. Nous avons longuement analysé l’ancienne caserne royale, sur laquelle il n’existait que des études partielles. Rapidement, deux évidences sont apparues avec force : d’abord, la nécessité de conserver l’ancien « hôtel des gardes du corps du Roi » (1825) et le pavillon des Officiers (v. 1860), deux édifices bien dessinés et que nous avons donc considérés, de fait, comme des monuments historiques non protégés ; ensuite, la volonté de rendre au site sa dignité et ses ouvertures sur le parc voisin et la Seine. Cela impliquait de démolir tous les bâtiments parasites élevés au grès des besoins par l’armée entre 1920 et 1970. Le Département des Hauts-de-Seine va donc dé-densifier la parcelle, pour aménager autour des deux édifices réhabilités des cours et jardins ouverts au promeneur et connectés au parc voisin. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec les services de l’État et notamment le Centre des monuments nationaux, gestionnaire du parc de Saint-Cloud. À l’intérieur des deux bâtiments du XIXe siècle, en revanche, le module répétitif des chambrées, devenues après 1945 des bureaux, comme l’absence de décor et même d’escalier d‘honneur, autorisaient une plus grande liberté. Nous avons donc souhaité pouvoir disposer de grands espaces, pour mettre le musée au large, avec un escalier monumental, une galerie, un cabinet, des espaces classiques – au XVIIe siècle – pour mettre les œuvres en valeur. Enfin, pour des raisons de sécurité, il était nécessaire d’isoler certaines fonctions dans un bâtiment neuf, situé dans l’angle sud-ouest de la parcelle et entouré de jardins ; son écriture comme son échelle constituaient un vrai défi – nous ne voulions en effet ni pastiche, ni coup d’éclat.

Quel projet le jury a-t-il retenu et pourquoi ?
Le jury, réuni le 29 mars dernier, a choisi le projet de Rudy Ricciotti, porté par le groupement Fayat Bâtiment. Les deux ans du dialogue compétitif nous ont permis d’obtenir trois projets de qualité, mais celui imaginé par R. Ricciotti proposait à la fois le traitement le plus puissant pour les façades de l’ancienne caserne, confiées aux soins de l’architecte en chef des MH C. Batard, et le dessin le plus beau pour le bâtiment neuf, dont l’enveloppe sera réalisée en béton blanc Bfup. À l’intérieur, enfin, l’architecte a dessiné un escalier à double révolution, dans le même matériau, d’une grande beauté. La scénographie sera réalisée par Frédéric Casanova (atelier FCS), au service des œuvres et du message que nous voulons porter.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Début juillet commence dans l’ancienne caserne une importante campagne de fouilles archéologiques, qui va durer huit mois et permettre une étude approfondie de la parcelle entière, bâtiments compris. Réalisé sur une prescription de la DRAC par l’Établissement interdépartemental 78-92, ce sera l’un des plus grands chantiers archéologiques d’Ile-de-France de l’année, et le public pourra le découvrir en avant-première le samedi 17 septembre, lors des Journées du Patrimoine. Nous déposerons à la rentrée le permis de construire, ce qui signifie que le chantier de réhabilitation devrait pouvoir commencer au printemps 2023. Notre impatience est grande ! Parallèlement, nous avons rédigé un important document d’orientation et achevé les inventaires de la collection, afin de pouvoir demander l’appellation « musée de France », délivrée par le ministère de la Culture. C’est une étape indispensable et l’une des conditions de la donation de Pierre Rosenberg.
Une préfiguration du musée a ouvert au Petit Château de Sceaux en septembre 2021 avec quelques-unes des œuvres phares de la collection. Où en êtes-vous des acquisitions et dépôts qui seront faits au musée ?
Depuis 2019, nous poursuivons en effet une politique d’acquisition ambitieuse : elle repose sur un comité d’experts, qui se réunit deux fois par an et vote à bulletin secret. Toutes ces œuvres – tableaux, mais aussi sculptures, mobilier, objets d’art… – sont présentées au Petit Château de Sceaux, notre pavillon de préfiguration, afin qu’on puisse les découvrir sans attendre l’ouverture du musée en 2026. Actuellement fermé et en travaux pour mieux recevoir le public, ce petit bâtiment du XVIIe siècle rouvrira ses portes début décembre : on y verra nos collections suivant un nouvel accrochage ainsi qu’une exposition d’une cinquantaine de dessins exceptionnels de la donation Rosenberg, dont la première étape a été présentée au Salon du dessin de mai dernier. Enfin, un important travail de recherche de dépôts se poursuit : je salue la générosité scientifique des collègues des musées nationaux et territoriaux, qui nous permet de nourrir notre discours et de montrer au public des œuvres devenues invisibles. Notre premier dépôt, grâce à la ville de Versailles, est un grand tableau de l’atelier de Mignard, La famille du Grand Dauphin du musée Lambinet. Nous l’avons fait restaurer et encadrer, et le public pourra donc le découvrir à Sceaux. D’autres dépôts prestigieux suivront rapidement : je n’en dis pas plus pour entretenir la curiosité et inciter le public à venir nous rendre visite…