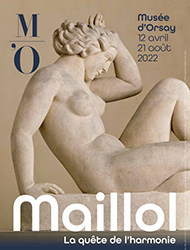Fermé durant sept mois pour travaux, le musée du Temps souffle ses 20 bougies. L’occasion de mettre en pleine lumière cette institution aussi remarquable qu’insolite.
Le projet de musée de l’horlogerie est évoqué dès le milieu du XIXe siècle, mais c’est seulement en juin 2002 qu’est inauguré le musée du Temps, dans un lieu emblématique du patrimoine bisontin : le palais Granvelle.
Un écrin et des collections d’exception
L’histoire de cette demeure Renaissance, construite pour le garde des Sceaux de Charles Quint, Nicolas Perrenot de Granvelle, et rachetée par la Ville en 1864, est évoqué au début du parcours. Après 20 ans d’existence, l’institution vient d’effectuer des travaux d’accessibilité et de repenser partiellement la présentation de ses riches collections. Le parcours réunit ainsi des centaines de montres, horloges comtoises, pendules, peintures, gravures et tapisseries, plan-relief, globes terrestre et céleste, instruments des Observatoires astronomiques de Paris et Besançon ou matériel pédagogique de l’École nationale d’horlogerie.
Temps, histoire et sciences
Conservatrice du musée, Laurence Reibel souligne que « trois fils directeurs se mêlent tout au long du parcours : l’histoire de la ville et de la région d’une part, l’histoire de la mesure du temps d’autre part, et enfin la représentation symbolique du temps ». Le passé de la ville est ainsi mis en lumière, depuis son appartenance à l’empire de Charles Quint au XVIe siècle, au moment de l’édification du palais, jusqu’au rattachement au royaume de France à la fin du XVIIe siècle. La galerie de la mesure du temps évoque la quête de précision et l’évolution tant technique qu’esthétique des garde-temps dès le XVIIe siècle, bien avant que Besançon ne s’illustre comme la capitale française de la montre. Mais les collections vont bien au-delà de la seule horlogerie et accordent une place de choix à la symbolique du Temps, en témoignent les vanités et natures mortes qui ponctuent le parcours. Les deux dernières acquisitions montrent bien la pluralité de cette approche du « temps » : l’horloge de Nicolas Hanet (1660), qui est l’une des premières horloges à balancier françaises, rejoint les instruments de mesure scientifique du temps, alors que le portrait de centenaire brossé par Johann Melchior Wyrsch est une évocation du temps qui passe.

Capitale de la montre
C’est à partir de la Révolution que Besançon devient un centre de production horlogère, grâce à l’installation d’une colonie d’horlogers suisses en 1793 (évoquant par exemple le Genevois Laurent Mégevand) suivie au cours du XIXe siècle par la création d’institutions publiques essentielles au développement de l’activité, telles que l’école d’horlogerie, l’observatoire dont la vocation première était de donner l’heure juste, puis le Cetehor, Centre technique de l’industrie horlogère, fondé en 1945. Cette histoire de l’horlogerie locale et régionale est particulièrement à l’honneur au deuxième étage du musée. La scénographie de cet espace a été repensée autour de la Leroy 01, qui fut pendant longtemps la montre la plus compliquée du monde. Autre pièce phare des collections, le pendule de Foucault, inauguré en octobre 2004 dans la tour du palais, fait l’objet d’une esthétique nouvelle.

Capitale de la montre, Besançon fournit en 1880 environ 90 % de la production française ! Si la crise des années 1930, puis la Seconde Guerre mondiale, et enfin la crise des années 1970 symbolisée par l’affaire Lip ont mis en péril cette activité, la ville qui conserve bien des traces de son riche passé, voit perdurer une activité horlogère et s’impose comme un pôle mondial des temps-fréquences. En décembre 2020, l’inscription par l’Unesco des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité sonne comme une véritable reconnaissance de la culture horlogère sur le territoire de l’Arc jurassien franco-suisse.
Myriam Escard-Bugat
Musée du Temps
96 Grande Rue, 25000 Besançon.
Tél. 03 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr