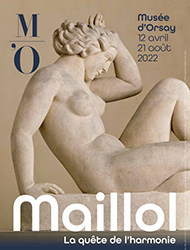Ses initiales sont « J.V. ». Si l’on pensera sans doute d’abord à Johannes Vermeer (1632-1675), récemment honoré à Amsterdam d’une retentissante rétrospective qui vient de fermer ses portes, il faudra désormais songer à son aîné, le peintre Jacobus Vrel, dont l’art énigmatique et silencieux n’est pas sans évoquer celui du « sphinx de Delft ». Afin de lever le voile du mystère, la Fondation Custodia lui consacre cet été à Paris une remarquable exposition monographique, après une première version plus modeste déployée au Mauritshuis de La Haye : elle réunit exceptionnellement vingt-trois tableaux et un dessin de l’artiste sur la quarantaine d’œuvres connues ; ils sont présentés en regard d’une belle sélection d’œuvres de ses contemporains du Siècle d’or hollandais.
Intérieur ou extérieur ?
Habituellement, l’ouverture est source de lumière et symbolise la frontière entre l’espace intérieur, si important pour Vrel, et le monde extérieur. C’est notamment le cas en 1656 dans Femme à la fenêtre. Dans Femme assise regardant un enfant par la fenêtre, bien connu des visiteurs de la Fondation Custodia, le peintre renverse le procédé avec un espace noir et son étonnant reflet lumineux, créant, si ce n’est l’angoisse, du moins la surprise. La fenêtre ici est intérieure – élément commun dans les habitations de l’époque –, ce qui dissipe bien vite l’idée d’une apparition venue du dehors, des ombres ou des limbes. La scène n’en est pas moins curieuse : l’instabilité de la chaise, témoin de la précipitation de la femme, apporte une dynamique que la douceur de la main posée sur la vitre vient atténuer. Plusieurs détails tranchent avec le vide apparent de la composition : l’une des brisures réparées du verre souligne le visage de l’enfant et, négligemment posé au sol, un bout de tissu sert de support à la signature de l’artiste, un procédé commun à plusieurs tableaux. On retrouve en outre dans ces deux vues d’intérieurs un motif récurrent de l’œuvre de Vrel : le service de faïence, habituellement posté sur le linteau de la cheminée.


Une première scène de rue
Ce tableau, probablement la première scène de rue de Vrel, réunit plusieurs motifs que l’on retrouve dans ses autres compositions. Le ciel est rejeté hors du cadre par la hauteur des étroites maisons, bloc monochrome oppressant face à la petitesse des passants – un sentiment cependant nuancé par l’animation tranquille de la rue. On discute devant l’étal du boulanger, tandis qu’au fond un homme se rend chez le barbier, dont l’enseigne, perche striée de blanc et de rouge d’où pendent des plats dorés, est un motif récurrent des « ruelles » de Vrel. Au centre de la composition, on peut percevoir un arbre chétif, souvent dissimulé dans ses scènes de rue. Précurseur d’un genre florissant dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’artiste peint ses rues en assemblant des motifs architecturaux, créant des décors de scènes, presque des espaces intérieurs, quotidiens et anonymes.

Cigogne ou cheminée ?
Le motif de l’étal de boulangerie revient à plusieurs reprises chez Jacobus Vrel ; l’artisan est ici visible, accoudé à sa fenêtre et identifiable à son bonnet rouge. Cette huile sur bois constitue une réplique, à quelques détails près, d’un précédent tableau qui figurait un nid de cigogne à la place de la cheminée centrale. Son analyse a récemment révélé que le peintre avait d’abord reproduit le nid initial, avant de le transformer en cheminée. L’étude de l’œuvre a aussi permis de conclure que Vrel avait probablement travaillé à Zwolle, petite ville de l’Est des Pays-Bas. Le pan de mur en bois dominé par la cheminée correspondrait en effet au chemin de ronde des remparts encerclant la ville. Des photographies de la cité datant des années 1960 révèlent même une vue quasi identique à celle du tableau.

Éloge du vide
La nudité des grands murs de chaux blanche, habillés d’un unique vêtement, signe là l’une des compositions les plus audacieuses de l’artiste. La pièce est dépeinte presque vide : outre le cerceau négligemment posé au sol et le morceau de tissu arborant la signature du peintre, seule la chaise sur laquelle est assise une fillette meuble l’espace. Une femme – sa mère ? – la peigne, probablement à la recherche de poux. Elle semble aussi concentrée sur sa tâche et son peigne que le garçonnet est captivé par l’extérieur. Il reste cependant derrière le battant de la porte fermière, n’osant pas sortir ; ce détail confère une belle profondeur à la composition. Dans ses tableaux, espaces souvent vides et presque clos, Vrel ne livre qu’un bref aperçu de ce qui se trouve de l’autre côté des ouvertures ; on ne peut qu’imaginer ce qui attire l’attention du garçon. L’artiste comble le vide de ses espaces en focalisant l’attention du spectateur sur les perceptions individuelles de ses sujets : du plus petit des poux à l’immensité du monde qui s’ouvre au-delà du seuil.

Un unique payage
Longtemps attribuée à Johanes Lingelbach (1622-1674), cette œuvre est le seul paysage connu de Jacobus Vrel. Ce tableau et deux autres de l’artiste, dont Femme à la fenêtre, faisaient partie de la prestigieuse collection de l’archiduc Léopold Wilhelm d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas du Sud au service du roi d’Espagne. Le descriptif de la collection, qui précise « Une pièce où l’on voit deux paysans et une paysanne. Par Jacob Fröll », est l’une des seules archives mentionnant – malgré une orthographe erronée – le peintre. Dans ce paysage aux belles couleurs récemment restauré, on reconnaît surtout les types de figurants dont Vrel peuple ses scènes de rue : l’homme vêtu de gris avec sa fine et longue canne et la femme à la coiffe blanche et au corset rouge, dont on ne voit que rarement le visage.

Gaspard Douin
« Jacobus Vrel. Énigmatique précurseur de Vermeer »
Jusqu’au 17 septembre 2023 à la Fondation Custodia
121 rue de Lille, 75007 Paris
Tél. 01 47 05 75 19
www.fondationcustodia.fr
Catalogue, Hirmer, 256 p., 39,90 €.
À découvrir également jusqu’au 17 septembre 2023 à la Fondation Custodia :
« Rein Dool. Les dessins »
Catalogue, Dordrecht Museum, Fondation Custodia, 116 p., 29,95 €.