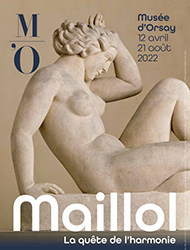Tandis que le salon FAB Paris ouvre ses portes dès demain au Grand Palais Éphémère, les galeries parisiennes organisent quant à elles une série d’expositions dans le cadre de la Semaine des Arts. Voici un florilège des événements à ne pas manquer, à quelques jours de leur fermeture.
Nathalie Motte reçoit les Parrocel
Nathalie Motte Masselink consacre une exposition à deux Parrocel : Charles (1688-1652) et Joseph-François (1701-1784). Ce dernier passa une grande partie de sa carrière à concevoir des décors éphémères pour des fêtes et des scènes de théâtre. Dès 1734, il travailla sous la direction de Giovanni Servandoni pour qui il réalisa un décor de scène. Après avoir poursuivi son activité de décorateur à Rome, Parrocel, de retour à Paris en 1746, se remit au service du théâtre, avec cette fois une production destinée à l’opéra. La composition du dessin Le Parnasse, exposé au Salon de 1757, a trait également à l’univers musical car il présente un sujet destiné à orner le fond d’une salle de concert.

Le siècle de Judit Reigl chez Dina Vierny
La galerie Dina Vierny célèbre le centenaire de la naissance de Judit Reigl. À travers une sélection d’une quinzaine d’œuvres, de 1954 à 2010, souvent de grands formats, l’exposition retrace une large partie de la carrière de l’artiste d’origine hongroise. La formule « Panta rhei » fut son mantra. Attribuée au philosophe grec Héraclite d’Éphèse, elle signifie « toutes les choses coulent » ou bien « tout se meut selon un certain rythme », en référence à la danse ou la ronde. Dans sa série Déroulement qui occupe une place centrale dans son œuvre, l’artiste développa l’idée d’un monde en mouvement perpétuel, qu’elle tenta de restituer avec des techniques où la gestuelle joue un rôle important.

Traverser le miroir chez Raphaël Durazzo
Chez Raphaël Durazzo, on est transporté de « L’autre côté du miroir » dans une exposition célébrant le surréalisme au féminin. Omniprésentes dans le mouvement, ces femmes artistes ont posé un regard singulier et éminemment transgressif sur le monde qui les entourait. Et pour cause, en raison de leur condition féminine, elles ont dû braver nombre d’interdits, familiers ou moraux pour exercer leur art, quitte à s’ostraciser. Ce ne sont plus seulement des muses ou des femmes d’artistes mais des artistes à part entière telles que Leonor Fini, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Jacqueline Lamba ou encore Meret Oppenheim qui mettent en scène leurs fantasmes à travers un monde plus onirique que celui créé par leurs homologues masculins, souvent enclins à privilégier une vision érotisée du corps féminin.

Les gouaches de Sol LeWitt chez Brame & Lorenceau
La galerie Brame & Lorenceau expose une trentaine d’œuvres sur papier de Sol LeWitt représentant une part emblématique de la production de l’artiste. Il s’agit de feuilles des années 1980-1990, période pendant laquelle ce pionnier des mouvements minimaliste et conceptuel développe un œuvre graphique de petits formats avec la gouache comme médium privilégié, parallèlement à la réalisation de Wall Drawings réalisés sur les murs. Sol LeWitt cherche « le moyen de décrire un objet tridimensionnel en termes bidimensionnels ». Il établit des réseaux complexes de formes et de couleurs, comme le montre cette kaléidoscopique et lumineuse gouache sur papier de 1988.

La poésie d’Olivier O. Olivier à la galerie de l’Institut
La galerie de l’Institut met à l’honneur le monde poétique et sensible d’Olivier O. Olivier, né à Paris en 1931. Lorsqu’il découvrit l’artiste dans une exposition chez Berggruen en 1990, Marc Lebouc qui dirige la galerie de la rue de Seine fut immédiatement séduit par cet univers au réalisme teinté « d’étrangetés discrètes, de bizarreries burlesques ». Ses œuvres invitent le spectateur dans des régions inexplorées où l’humour le dispute à l’insolite. Jeux visuels autant que verbaux évoquent le travail de Marcel Duchamp, comme dans le très beau fusain Vogue audacieux pianiste (2004) qui montre un pianiste et son instrument presque immergés au cœur d’une immense vague.

Vallayer-Coster reine des fleurs à la galerie Coatalem
Faubourg Saint-Honoré, la galerie Coatalem offre à Anne Vallayer-Coster (1744-1818), gloire de la nature morte à l’heure des Lumières, sa première exposition parisienne. Paris, Salon de 1771. « Melle Vallayer nous étonne autant qu’elle nous enchante. C’est la nature rendue ici avec une force de vérité inconcevable, et en même temps, une harmonie de couleurs qui séduit. » Les louanges tressés par Diderot à Anne Vallayer-Coster (1744-1818) témoignent de l’enthousiasme critique que celle-ci suscite dès sa première participation au Salon. Vingt ans après avoir vendu au National Museum of Women in the Art de Washington la remarquable effigie de Madame de Saint-Huberty dans le rôle de Didon, Éric Coatalem renoue avec l’artiste en réunissant, pour la première fois à Paris, plus d’une vingtaine des natures mortes qui forgèrent sa réputation. C’est en effet principalement à travers ce genre, jadis considéré comme étant l’apanage des femmes, qu’Anne Vallayer-Coster sut démontrer l’étendue de sa virtuosité ; il lui offrira, tout au long de sa carrière, une constante notoriété. O.P.-M.

Nathalie Mandel