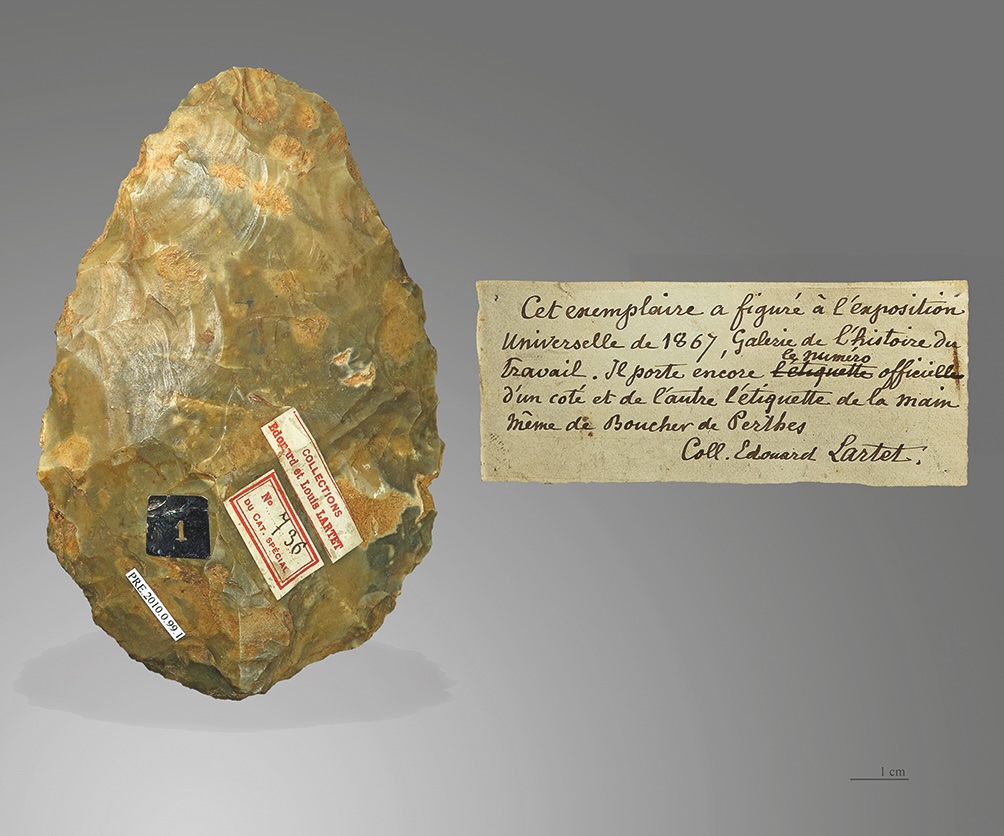
Mot. Trois lettres, et voici « le mot du mois » lancé par lui-même, pris à son propre jeu. Un jeu de mot, un mot d’archéologie. Un mot d’émoi chaque mois. Et pourquoi celui-là, là en ouverture au milieu de tous ceux qui existent, si nombreux et en apparence plus archéologiques ?
La réponse est là, sous nos yeux et dans nos travaux érudits. Sans le mot, l’archéologie n’existe pas. Elle est logos, discours, et ne saurait donc se passer de cet outil qui lui permet de dire et de partager ce qu’elle trouve, classe, étudie, voit, comprend. Pourtant, sa matière première n’est guère bavarde. Science des traces matérielles laissées par les hommes et les sociétés du passé, elle enquête sur des données en apparence muettes. Et immobiles. Dans leur immense majorité à l’échelle de l’histoire humaine, ces sources ne portent pas de nom. Pour les faire exister au-delà de leur matérialité, les archéologues ont donc mobilisé des mots pour les désigner, leur donner une identité, un sens. Des mots empruntés au monde contemporain (céramique), des mots imaginés puis abandonnés (pierres de foudre) ou conservés (Néolithique). Celui d’« archéologie » est lui-même une création dont les prémices se trouvent chez Platon. Les archéologues sont des inventeurs de mots par nécessité, avec poésie et imagination souvent. Et même talent parfois. Au service d’une aspiration, d’un dessein : mettre en récit celles et ceux qui se sont tus il y a peu ou longtemps et auxquels ils redonnent ainsi parole et vie.
Anne Lehoërff
Professeur des universités, CY Cergy Paris Université























