
Malgré certaines imperfections, l’archéologie française est l’une des plus fortes et des plus structurées en Europe. Mais cette archéologie de pointe ne se fait ni sans réflexion, ni sans axe de recherche. C’est l’une des tâches dévolues au Conseil national de la recherche archéologique. Rencontre stimulante avec Anne Lehoërff, sa vice-présidente, professeur des universités à Cergy Paris université, qui nous livre sa vision de cette science en 2023, avec ses atouts et ses faiblesses.
Propos recueillis par Éléonore Fournié.
Vous êtes vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologie (CNRA). Depuis quand ce conseil existe-t-il et quelles sont ses missions ?
Le CNRA est né en 1994 d’une mutation du Conseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA), alors que l’époque connaissait une explosion des fouilles et la naissance de la notion d’archéologie préventive au lendemain de la Convention de Malte (1992). Si le CNRA est placé sous la tutelle du ministère de la Culture (le ou la ministre est le ou la président/e en titre du CNRA), il a un caractère profondément interministériel : le ou la vice-président/e relève ainsi traditionnellement du monde académique, c’est-à-dire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les missions du CNRA sont de deux natures : la première est une expertise scientifique des 60 opérateurs nationaux en archéologie préventive (un chiffre de 2023 qui varie), délivrant des agréments (pour les structures privées) ou des habilitations (pour les collectivités territoriales) d’une durée de 5 ans, qui certifient que l’opérateur a les compétences requises pour mener des fouilles et des recherches. L’agrément ou l’habilitation est délivré par période (Paléolithique, Néolithique, âges des métaux…) et repose sur un porteur (un spécialiste). Cela accompagne l’idée que, dès la phase de terrain, l’archéologie, qu’elle soit programmée ou préventive, n’est pas là pour « libérer le terrain » selon l’expression que l’on entend parfois, mais repose sur un projet scientifique construit et cohérent. Y compris lorsqu’elle accompagne des travaux d’aménagement, l’archéologie a pour objectif de produire de la connaissance. Depuis 2001 et la première loi en France, elle a démontré sa capacité à remplir cette mission, à affirmer sa valeur heuristique. Le CNRA examine quelque 30 à 50 dossiers par an d’ampleur variable. Nous émettons des avis et la décision revient, in fine, au ministre de la Culture qui la co-signe avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Quant à la seconde mission, elle relève de ce que j’aime appeler la « science libre ». C’est important de rappeler que, dans la science, la liberté de penser sans entrave et sans contrainte (politique, sociale, religieuse) est fondamentale ! Le CNRA, qui est un conseil scientifique et non l’administration, se donne ainsi comme objectif de réfléchir et de débattre sur l’archéologie d’aujourd’hui et de demain, de se positionner sur tel ou tel aspect – comme la question des restes humains, le pillage, les archives et le tri. C’est essentiel, y compris sur le plan éthique, dans un domaine qui s’est considérablement renouvelé ces dernières décennies dans ses questionnements (presque sans limite) et les cadres de sa pratique (au contraire de plus en plus structurée). Le ministère peut aussi demander notre éclairage sur certains sujets : par exemple la notion de site archéologique ou l’archéologie face aux questions environnementales et éthiques, face au patrimoine en danger, etc.

Parmi les grands chantiers du CNRA, figure la Programmation nationale de la recherche archéologique. Pourriez-vous nous la présenter ?
Dès les années 1970, est née l’idée que des axes de recherches en archéologie étaient pertinents, structurants. C’est important que la communauté des chercheurs pense collectivement les orientations, chantiers et thématiques à développer sur le terrain, dans les programmes post-fouilles ou ceux collectifs de recherche, voire qu’ils servent de leviers à des projets internationaux et européens. On le sait, on n’identifie que ce que l’on est en capacité d’appréhender : si le regard n’est pas formé, éduqué à voir quelque chose, il peut passer complètement à côté du vestige, de la source historique. La Programmation ne se prétend pas exhaustive et elle ne bride pas les individualités. Elle se veut force de proposition. Par exemple, l’habitat de l’Âge du bronze se laisse difficilement attraper sur des petites surfaces ; il faut donc inviter à des ouvertures de fouilles assez grandes pour pouvoir le percevoir. Comprenons bien que, sur le terrain, nous ne travaillons pas de manière aléatoire (ou pour le plaisir d’éventrer la France !), mais en associant un rôle actif dans l’aménagement des territoires avec une réflexion sur des ambitions scientifiques. Réunissant une centaine d’auteurs, la Programmation de 2023 comporte 16 axes thématiques ; elle a actualisé et perfectionné celle de 2016 (qui était la première du genre depuis une vingtaine d’années). Elle est très importante car elle touche toute l’archéologie française qui demeure, je le répète, une et indivisible. La nouvelle Programmation redonne sens, par la science, à cette réalité.

En juin dernier, se tenaient à Paris les Assises scientifiques de l’archéologie. Merci d’y avoir invité Archéologia. Quels bilans en tirez-vous ?
Je retiendrais au moins deux aspects. L’un est humain, dans le sens où tous les représentants de l’archéologie ont été présents, y compris ceux qui ne se rencontrent pas toujours. Je trouvais intéressant par exemple de réunir les Écoles françaises à l’étranger et les collectivités territoriales et de se rendre compte qu’elles ont des problèmes et des enjeux de recherche qui, bien souvent, se croisent ! Cela permettait de sortir de l’idée que chacun est dans son monde. Et il n’y a pas des archéologies nobles et d’autres qui ne le seraient pas. L’un de mes combats est de lutter contre l’idée des « grandes » civilisations qui sous-entend qu’il y en a des « petites », dans des hiérarchies inacceptables aujourd’hui. En outre, dans cette vision, notre propre histoire européenne non méditerranéenne est dévalorisée, ce n’est pas anodin. Toute étude, tout chantier est important et l’archéologue est un historien à part entière – qu’importe qu’il y ait de l’écriture ou pas – qui travaille avec une documentation comportant, comme toutes les documentations, des lacunes, des prismes déformants, etc. L’archéologie n’est pas une auxiliaire ou une petite sœur de l’histoire : c’est une science cumulative où chacun apporte sa pierre à l’édifice. Cela rejoint le deuxième aspect qui a émergé de ces journées : nous avons abordé quasiment tous les sujets scientifiques touchant à l’archéologie d’aujourd’hui, en se fondant sur les 16 axes de la Programmation. Une publication de ces journées suivra la mise en ligne sur Internet car nous souhaitons partager ces résultats.
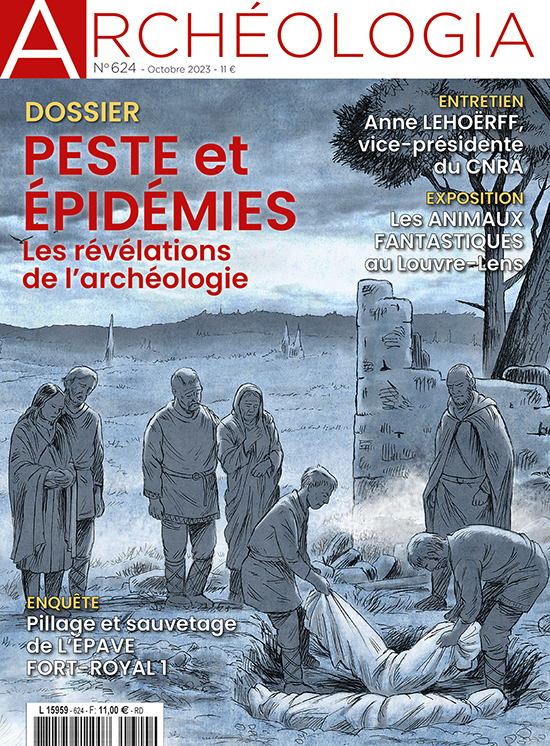
Entretien à retrouver en intégralité dans :
Archéologia n° 624 (octobre 2023)
Peste et épidémies, les révélations de l’archéologie
81 p., 11 €.
À commander sur : www.archeologia-magazine.com























