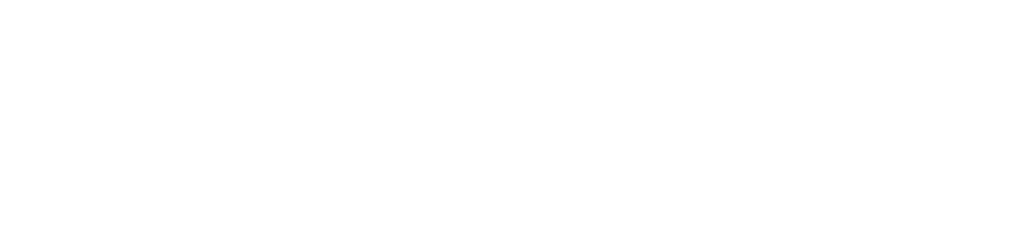Fondée en 910 par Guillaume d’Aquitaine, l’abbaye bénédictine de Cluny est, au Moyen Âge, le plus grand monastère de la chrétienté occidentale. La vie monastique s’y organise autour de nombreux bâtiments, qui sont en grande partie détruits à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution. Initiées en 1928, d’amples recherches archéologiques se poursuivent aujourd’hui et enrichissent considérablement notre connaissance de ce site majeur, dont l’ordre a rayonné dans toute l’Europe.
En 1794, pendant les grandes heures de la Révolution, les experts Louis Colas et Claude Philibert dressent une estimation « des bâtiments, églises, jardins, moulins et dépendances de la cy-devant abbaye dudit Cluny », dont l’État cherche à se défaire. Dès 1798, une grande partie du monastère est vendue, soit dix hectares de bâtiments. Pour faciliter la tâche, Pierre Jean Guillemot, ingénieur en chef du département, est chargé de diviser l’abbaye en quatre lots : deux rues perpendiculaires doivent être percées au détriment du cloître et de l’église abbatiale. Ils sont vendus le 21 avril à une association, pour la somme de 60 000 francs. L’abbaye est progressivement dépecée durant plus de vingt ans. Il ne reste aujourd’hui que les bras sud du grand transept de la Maior Ecclesia, et quelques bâtiments monastiques, comme l’hôtellerie Saint-Hugues, le farinier et différentes tours de l’enceinte, dont la tour du Moulin et la tour des Fèves, ainsi que les deux palais abbatiaux. Les bâtiments monastiques du XVIIIe siècle, qui accueillent rapidement une école technique, devenue en 1904 l’École des arts et métiers, ont été, en revanche, entièrement conservés. Le bourg monastique est, quant à lui, particulièrement bien préservé.

Le congrès du millénaire
Depuis le début du XXe siècle, les historiens se sont intéressés aux vestiges de l’abbaye de Cluny, qui présentaient, malgré les très nombreuses destructions, un projet architectural d’envergure. C’est lors du congrès organisé in situ du 10 au 12 septembre 1910, à l’occasion du millénaire de la fondation de l’abbaye, que Jean Virey publie pour la première fois le plus ancien plan du monastère. Celui-ci, réalisé dans les années 1700 avant les grands travaux de restructuration de l’abbaye, est aujourd’hui conservé sous le nom de « plan anonyme ». Les travaux de l’historien de l’art à partir du Dénombrement de 1623 montraient qu’au-delà de l’analyse de l’architecture et de la sculpture romane clunisienne
la grande abbaye bourguignonne pouvait susciter de nouvelles recherches sur l’organisation des espaces monastiques.

Une continuité d’occupation depuis l’Antiquité
Les recherches archéologiques initiales ont été menées de 1928 à 1950 par Kenneth John Conant, le premier à tenter de restituer les grandes phases de construction du monastère. Elles se poursuivent depuis les années 1990 dans le cadre de fouilles préventives ou de programmes de recherches (CNRS/CEM et université Lyon 2). Aujourd’hui, la connaissance de l’abbaye de Cluny au Moyen Âge et de son développement jusqu’à l’époque moderne bénéficie considérablement de l’ensemble de ces travaux, qui confirment ou infirment
les thèses de l’archéologue américain. L’analyse des églises successives et la fouille des bâtiments conventuels sont les sujets qui ont certainement suscité le plus d’intérêt parmi les chercheurs. Les travaux actuels sur le terrain, non exposés ici car non finalisés, montrent que l’abbaye s’inscrit dans une continuité d’occupation depuis l’Antiquité, avec un aménagement progressif du site naturel. Ainsi la fondation de l’abbaye par Guillaume d’Aquitaine en 910 intervient-elle dans un environnement considérablement construit. Le nombre d’églises abbatiales semble se réduire à deux, et non plus à trois comme on le supposait ; le cloître offre également une configuration nouvelle.

Anne Baud

Article à retrouver en intégralité dans :
Dossiers d’Archéologie n° 419
Cluny. Découvertes récentes
80 p., 12 €.
À commander sur : www.dossiers-archeologie.com